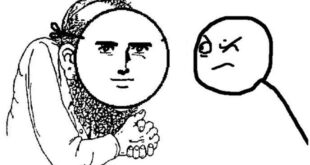Capitaine Harlock
Démocratie Participative
03 septembre 2017
Pour une fois, le journal juif Le Monde a produit un article qui vaut la peine d’être lu. C’est d’ailleurs écrit par un arabe, un certain Zineb Dryef, mais l’histoire rapportée est vraiment excellente.
En fait, c’est le récit du retour brutal à la réalité vécu par des petits bourgeois gauchistes – des profs – qui doivent sauver à tout prix leurs enfants de l’inondation islamo-nègre.
Le Monde :
Un quartier banal, dans une petite commune des Vosges. Autrefois – il n’y a pas si longtemps, jusqu’au début des années 2010 –, l’école du coin grouillait de toutes sortes d’enfants. Des enfants d’ouvriers et des enfants de cadres, des enfants de profs et des enfants de chômeurs, des enfants d’ici et d’ailleurs et des enfants plus tout à fait d’ailleurs mais qu’on appelle toujours les « enfants d’immigrés ». En somme, l’école rassemblait tout le monde. Mais, petit à petit, certains l’ont désertée pour les « bonnes » écoles du centre ou l’école privée du quartier, celles fréquentées par des « gens comme il faut ». L’école s’est mise à ressembler aux établissements ghettos, ceux dont on parle dans les journaux, et qu’il faut éviter à tout prix. Florence n’a pas compris. De ses voisins, elle a pensé qu’ils étaient snobs. Elle s’est dit qu’elle ne ferait jamais un truc pareil.
Pourtant, dans quelques jours, Baptiste et Maxence, ses deux fils, changeront eux aussi d’école. Fini la REP + (réseau d’éducation prioritaire renforcé) à moins de 500 mètres de la maison. L’aîné entre en sixième dans le collège où ses parents enseignent. Le cadet intègre une « bonne » école.
Au début des années 2000, quand Florence et son compagnon (qui ont souhaité garder l’anonymat) s’installent dans leur nouveau quartier, ils n’ont pas d’enfants, mais la perspective de scolariser ceux qu’ils auront un jour dans un établissement près de chez eux les enchante. On irait à l’école à pied, la vie serait douce. Tous deux enseignent les mathématiques dans le public, ils ne se posent même pas la question : en France, on ne choisit pas son école, on va à l’école de secteur.
Quand des copains conseillent un peu abruptement de ne pas sacrifier leurs enfants à leurs principes (« Nous, on ne l’inscrira jamais ici ») et qu’un voisin lâche : « Il y a trop d’Arabes maintenant », le couple tient bon. Attachés à l’enseignement public, ils ne veulent pas participer à ce « truc », la ghettoïsation galopante de leur école, et plus largement de l’école publique. Il y a bien quelques anicroches, les insultes chez les tout-petits, les réunions de parents d’élèves à cinq ou six, le bruit dans la classe dont se plaignent les enfants, ces mômes debout sur la table en plein cours, mais ils parviennent à les balayer. « C’était une ambiance particulière, c’est vrai, résume Florence. Mais les enfants avaient de bons copains et leurs enseignants étaient super. Ça se passait vraiment bien. »
Vraiment bien.
Jusqu’à l’entrée à l’école élémentaire : « On nous a dit que Baptiste devait sauter une classe. » Florence panique. Son fils est né en décembre, il est encore tout petit et, même s’il sait déjà lire, le psychologue scolaire le trouve un peu immature. Les parents refusent. En fin de CP, l’institutrice revient à la charge. « Vous comprenez, les autres enfants ont un niveau de milieu de CP, on ne peut pas le laisser stagner. » Quand elle suggère qu’ils auraient « quand même » pu le mettre dans une école du centre, c’est le coup de massue. « J’ai culpabilisé, je me suis dit que je n’avais pas fait le meilleur pour mes enfants, que j’aurais dû y réfléchir. J’ai aussi culpabilisé parce que je tiens à la mixité. Mais là, ce n’est pas de la mixité, c’est n’importe quoi, on a laissé se former des ghettos. Ce ne sera pas nous qui changerons les choses, mais c’est nos enfants qui en subissent les conséquences. A notre tour d’être égoïstes. » Comme beaucoup de parents de la classe moyenne supérieure, elle a préféré partir pour « ne pas subir ».
« La mixité » est bien sûr un euphémisme pour ne pas parler de « mélange racial ». Et cette sale prof a imposé à ses gosses les conséquences de son dogmatisme idéologique. En l’occurrence, la grande parousie post-raciale.
Car le recours à l’enseignement privé demeure important en France : plus d’un élève sur cinq y est scolarisé dans le secondaire. Et, tous les ans, les établissements gagnent quelque 7 000 élèves. « Je suis un peu tiraillée, admet Séverine Albe-Tersiguel, chargée d’étude dans une agence d’urbanisme et mère de trois enfants âgés de 16, 13 et 10 ans. Il y a mes grands principes d’un côté, et l’urgence : qu’est-ce que je fais pour mes enfants ? » Quand sa famille a quitté Paris pour Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), elle était plutôt confiante. « On avait des amis, trois ou quatre familles, plutôt militantes, avec qui on s’était dit que nos enfants resteraient ensemble, iraient dans le même collège. » Mais la mixité sociale tant vantée quand les enfants étaient en élémentaire est devenue problématique l’année de l’entrée en sixième. « Bon… Nos amis sont tous allés dans le privé. Ils disaient des choses aussi agréables que : “Je ne veux pas sacrifier mes enfants.” Mais en mettant Léonie au collège du coin, je n’avais pas non plus l’intention de la sacrifier ! Saint-Ouen se gentrifie, ça se voit à l’école primaire. Et plus du tout au collège et au lycée. »
Sa fille Léonie, sur les conseils de ses enseignants d’élémentaire, intègre une classe bilangue dans un collège public de Saint-Ouen. « Ses profs ne nous ont pas dit d’éviter ce collège mais ils ont fortement insisté pour la classe bilangue. La bonne classe. » Les premières années, l’adolescente est ravie. Elle a des copines et des bonnes notes. La classe, qui regroupe les bons élèves, demeure relativement imperméable aux agitations du collège. En troisième, pour tenter d’introduire plus de mixité dans les classes, les bilangues sont mélangés aux autres. « On appelait ma fille “la céfran”… Une de ses amies n’avait pas le droit de venir chez nous… Son profil était un peu particulier dans le collège », regrette sa mère.
L’ingénierie communiste à l’œuvre. Magnifique.
Cette même année, l’ambiance se dégrade. Des élèves s’en prennent physiquement à des professeurs. Une longue grève oppose l’équipe enseignante à la nouvelle principale. « C’était dur. » A la fin de l’année, tout le monde respire : Léonie est admise à Louis-le-Grand, lycée d’excellence parisien – l’admission, ouverte à tous les collégiens, se fait sur dossier –, et sa scolarité s’y déroule bien. Sa petite sœur, Suzanne, est inscrite dans une école privée du 10e arrondissement de Paris. Désormais les filles prennent le métro pour aller en classe. « J’avais l’impression de revenir sur mes principes, mais elle s’y sent bien. Si la qualité de l’enseignement n’est pas franchement meilleure dans le privé, il y a un tri des enfants sur dossier et les plus dissipés ne sont pas admis. » Pour son petit dernier, Gustave, qui doit entrer en sixième en septembre 2018, Séverine Albe-Tersiguel ne se ferme aucune porte : « J’ai l’impression qu’il n’y a pas de bonne solution. Je pense à la classe bilangue du collège où était Léonie – il semblerait que ça se passe mieux –, mais je vais aussi l’inscrire, par précaution, dans le collège privé de Suzanne. Pour nous laisser le temps de la réflexion. »
« J’avais l’impression de revenir sur mes principes ». Mais j’ai préféré penser à ma gueule en douce tout en continuant, le reste du temps, à soutenir Mélenchon et à dégueuler sur les « beaufs » frontistes.
Quand elles ne font pas le choix du privé, une solution demeure pour les familles qui veulent se rapprocher de leur établissement rêvé. Fournir une fausse adresse – ce qui implique de connaître quelqu’un dans le secteur élu –, voire déménager. Thomas, commercial et père de deux adolescentes, a quitté Saint-Denis pour Vincennes (Val-de-Marne) : « C’était ça ou le privé. Alors oui, c’est un peu faux-cul de partir pour se rapprocher d’un bon établissement, mais je n’avais pas vraiment le choix. Autour de moi, personne ne mettait ses enfants dans les collèges de la ville. Je n’avais pas envie d’expérimenter mes idées sur mes filles. » Thomas concède, empêtré dans ses contradictions, que voir ses enfants fréquenter une école « cocon » où il n’y a que des enfants « comme [eux] » l’embarrasse un peu.
Ces gens sont proprement repoussants.
Une révolution culturelle de type maoïste s’impose. Une purge des intellectuels, artistes, professeurs et éléments déviants de la bourgeoisie.
Une révolution culturelle de type maoïste s’impose. Une purge des intellectuels, artistes, professeurs et éléments déviants de la bourgeoisie.

Tout ce fatras, en Afrique !
 Démocratie Participative 卐 Le site le plus censuré d'Europe 卐
Démocratie Participative 卐 Le site le plus censuré d'Europe 卐